Titre : Revue internationale des produits coloniaux
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1942-11-01
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343784169
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 7259 Nombre total de vues : 7259
Description : 01 novembre 1942 01 novembre 1942
Description : 1942/11/01 (A17,N191)-1942/12/31. 1942/11/01 (A17,N191)-1942/12/31.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64374721
Source : CIRAD, 2012-231858
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
- Aller à la page de la table des matières181
- SOMMAIRE
- .......... Page(s) .......... 182
- Les richesses minières du sous-sol africain. - Ressources Forestières de l'Empire Français. - La culture de l'hévéa en Indochine. - Les richesses économiques de Bornéo. -L'Industrialisation du Maroc. - Echos et Informations. - Bibliographie De nos correspondants
- Table des Matières (année 1942).
- Table des Matières Année 1942
REVUE INTERNATIONALE DES PRODUITS COLONIAUX
193
Mining Co., LM). Ces mines sont reliées au centre
de Somabula par plusieurs autostrades et un che-
min de fer, inauguré en 1928. Les gisements du
Mashaba, dans le district de Victoria, sont exploi-
tés par deux mines, « King » et « Gath' s », appar-
tenant toutes les deux à la Rhodesian and General
Asbestos Corporation, Ltd, et ces gisements ressem-
blent beaucoup à ceux de Shabanie, avec des ré-
serves assez considérables. Mashaba est reliée par
une autostrade de 45 kilomètres à Fort-Victoria,
éloigné de 1.100 kilomètres par voie ferrée du port
de Beira.
La production des mines de la Rhodesian and
General Asbestos Company Ltd, qui était de 15.765
tonnes en 1932, s'élevait en 1937 à 57.014 tonnes.
La préparation du minerai fraîchement extrait de-
mandait deux semaines au moins de façon à per-
mettre l'élimination du surplus d'humidité. En-
suite, le minerai brut passe entre les mains des tra-
vailleurs indigènes qui séparent l' amiante de la terre
et des fragments de roc. Le minerai ainsi préparé
est mis dans des étuves, où le séchage a lieu par
chaleur et aspiration. C'est pendant cette opération
que l'on procède aussi au décollage des fibres
d'amiante. Elles sont ensuite triées, d'après leur
longueur, dans des machines spéciales, puis expé-
diées, en sacs de 150 livres (68 kg.), par téléféri-
que, jusqu'à la gare de chemin de fer.
L'amiante qui se trouve dans les gisements de
l'Union Sud-Africaine est d'une qualité de beau-
coup supérieure à celle de l'amiante rhodésien. Il
y en a de deux sortes, l'amosite et l'amiante bleu,
ou crokydolithe, qui sont de beaucoup supérieurs
au chrysotil par la longueur de leurs fibres et par
leur résistance physique et chimique. Les gisements
sud-africains se trouvent sur une longueur de 400
kilomètres. Les réserves de crokydolithe sont pres-
que inépuisables, et elles s'étendent de Prieska,
sur l'Orange, par-dessus les Montagnes d'Amiante,
dans le Griqualand et le Betchouanaland, et au
Nord, jusqu'au Kuruman. Les gisements d'amosite
se trouvent sur une longueur de 100 kilomètres en-
viron, dans la partie septentrionale du Transvaal,
dans la région de Lydenbourg et de Pietersbourg.
Les mines les plus riches de l'Union Sud-Afri-
caine sont celles de Kaapsche Hoop, Swazieland et
des Asbestos Mountains. La production s'élevait à
19.670 tonnes en 1937. Sept compagnies minières
sont actuellement occupées à en extraire l' amiante.
Les deux sociétés les plus importantes sont la Cape
Asbestos Company, Lid, propriétaire des mines de
la colonie du Cap (Hay District et Criqualand) et
la société américaine Turner and Newall, Ltd, qui
possède les mines de Kaapsche Hoop, au pied des
monts du « Draken », dans le Transvaal oriental,
les mines d'amiante de Havelock Wilson, dans le
Swazieland, et enfin les mines de crokydolithe du
Betchouanal and.
L'importance des minerais d'amiante se mesure
à la proportion relative de fibres d'amiante et de
terre. La valeur commerciale des minerais se rap-
porte aux qualités physiques et chimiques des fibres,
qui sont très variables. Les principales qualités, que
l'on recherche, sont la longueur de la fibre, sa flexi-
bilité, sa résistance à la traction, sa pureté, les pos-
sibilités de tissage, les propriétés isolantes et enfin
la résistance à la chaleur et à l' action des acides.
Les phosphates
Le continent africain livre un tiers de la produc-
tion mondiale de phosphates; il est, par conséquent,
un des plus importants producteurs du monde. Sa
production, qui s'élevait à 4.570.000 tonnes en j
1938, se répartit pour 90 en Afrique du Nord
française, c'est-à-dire la Tunisie (2.034.000 tonnes),
le Maroc français (1.487.000 tonnes) et l'Algérie
(584.500 tonnes), tandis que l'Egypte ne produit
que 458.400 tonnes et la Nigérie 5.700 tonnes seu-
lement.
Les gisements de la Tunisie se trouvent répartis
en deux grandes régions : celle de Gafsa, au Sud,
à 200 kilomètres environ à l'ouest du port de Sfax,
et celle de Kalaa-Djerda, à l'ouest de la ville de
Tunis. Les gisements de Gafsa contiennent de 58 à
65 de phosphate de calcium, et ceux de Kalaa-
Djerda atteignent une proportion de 60 à 63
Les réserves sont évaluées à 1.500.000.000 de
tonnes environ. Les trois principales sociétés exploi -
tatrices sont la Compagnie des Phosphates et du
Chemin de fer de Gafsa, la Société des Phosphates
tunisiens et des Engrais et Produits chimiques, et
enfin la Compagnie tunisienne des Phosphates du
Djebel-Mdilla. La production tunisienne se trouve
seconde seulement à la production américaine. Les
mines de Metlaouï, où ont été faites les premières
extractions de phosphates de Tunisie, sont reliées au
port de Sfax par un chemin de fer d'une longueur
de 243 kilomètres. Les cinq puits de mines de Gafsa
ont produit depuis leur mise en exploitation plus de
45 millions de tonnes. Les phosphates s'y trouvent
sous forme de couches étendues et régulières, dont
l'épaisseur varie de 1 à 3,5 mètres. La production
de phosphates tunisiens est considérable. Elle a at-
teint son point maximum en 1930, avec 3,326.000
tonnes. Une usine pour la préparation des super-
phosphates se trouve à El-Afrance. Quant à la pro-
duction tunisienne, 90 environ sont absorbés par
la France, tandis que le reste, soit 10 %, est ex-
porté en Grande-Bretagne. Le nombre des travail-
leurs employés dans les mines de Tunis s'élève à
10.000. Depuis 1938, les producteurs de phospha-
tes se sont groupés en une Société tunisienne d'Etu-
des et de Coopération et de Défense de l'Industrie
des phosphates, dont le but est d'améliorer les chif-
fres de production et les procédés techniques de
l' extraction.
La production du Maroc français est très rap-
prochée de celle de Tunis. Le droit de prospection
et d'exploitation des phosphates y est devenu, de-
puis 1920, un monopole d'Etat et il est géré par
un Office chérifien des Phosphates. La production
marocaine, commencée en 1908, se concentre sur
les gisements très riches de Kourigha et de Gann-
tour. Les mines de Kourigha se trouvent près de la
voie ferrée allant à Casablanca, et les gisements,
évalués à 1 milliard de tonnes environ, contiennent
75 à 76 de phosphates de calcium. Les mines
de Gnantour. ouvertes en 1933, se trouvent près de
la gare de Ben Guérir, sur la voie ferrée allant de
Marrakech à Casablanca, et les gisements contien-
nent de 68 à 70 de phosphates, mais ils sont
moins riches que ceux de Kourigha, qui produisent
quatre cinquièmes de la production marocaine toute
entière. Les gisements de Kourigha et de Ganntour
193
Mining Co., LM). Ces mines sont reliées au centre
de Somabula par plusieurs autostrades et un che-
min de fer, inauguré en 1928. Les gisements du
Mashaba, dans le district de Victoria, sont exploi-
tés par deux mines, « King » et « Gath' s », appar-
tenant toutes les deux à la Rhodesian and General
Asbestos Corporation, Ltd, et ces gisements ressem-
blent beaucoup à ceux de Shabanie, avec des ré-
serves assez considérables. Mashaba est reliée par
une autostrade de 45 kilomètres à Fort-Victoria,
éloigné de 1.100 kilomètres par voie ferrée du port
de Beira.
La production des mines de la Rhodesian and
General Asbestos Company Ltd, qui était de 15.765
tonnes en 1932, s'élevait en 1937 à 57.014 tonnes.
La préparation du minerai fraîchement extrait de-
mandait deux semaines au moins de façon à per-
mettre l'élimination du surplus d'humidité. En-
suite, le minerai brut passe entre les mains des tra-
vailleurs indigènes qui séparent l' amiante de la terre
et des fragments de roc. Le minerai ainsi préparé
est mis dans des étuves, où le séchage a lieu par
chaleur et aspiration. C'est pendant cette opération
que l'on procède aussi au décollage des fibres
d'amiante. Elles sont ensuite triées, d'après leur
longueur, dans des machines spéciales, puis expé-
diées, en sacs de 150 livres (68 kg.), par téléféri-
que, jusqu'à la gare de chemin de fer.
L'amiante qui se trouve dans les gisements de
l'Union Sud-Africaine est d'une qualité de beau-
coup supérieure à celle de l'amiante rhodésien. Il
y en a de deux sortes, l'amosite et l'amiante bleu,
ou crokydolithe, qui sont de beaucoup supérieurs
au chrysotil par la longueur de leurs fibres et par
leur résistance physique et chimique. Les gisements
sud-africains se trouvent sur une longueur de 400
kilomètres. Les réserves de crokydolithe sont pres-
que inépuisables, et elles s'étendent de Prieska,
sur l'Orange, par-dessus les Montagnes d'Amiante,
dans le Griqualand et le Betchouanaland, et au
Nord, jusqu'au Kuruman. Les gisements d'amosite
se trouvent sur une longueur de 100 kilomètres en-
viron, dans la partie septentrionale du Transvaal,
dans la région de Lydenbourg et de Pietersbourg.
Les mines les plus riches de l'Union Sud-Afri-
caine sont celles de Kaapsche Hoop, Swazieland et
des Asbestos Mountains. La production s'élevait à
19.670 tonnes en 1937. Sept compagnies minières
sont actuellement occupées à en extraire l' amiante.
Les deux sociétés les plus importantes sont la Cape
Asbestos Company, Lid, propriétaire des mines de
la colonie du Cap (Hay District et Criqualand) et
la société américaine Turner and Newall, Ltd, qui
possède les mines de Kaapsche Hoop, au pied des
monts du « Draken », dans le Transvaal oriental,
les mines d'amiante de Havelock Wilson, dans le
Swazieland, et enfin les mines de crokydolithe du
Betchouanal and.
L'importance des minerais d'amiante se mesure
à la proportion relative de fibres d'amiante et de
terre. La valeur commerciale des minerais se rap-
porte aux qualités physiques et chimiques des fibres,
qui sont très variables. Les principales qualités, que
l'on recherche, sont la longueur de la fibre, sa flexi-
bilité, sa résistance à la traction, sa pureté, les pos-
sibilités de tissage, les propriétés isolantes et enfin
la résistance à la chaleur et à l' action des acides.
Les phosphates
Le continent africain livre un tiers de la produc-
tion mondiale de phosphates; il est, par conséquent,
un des plus importants producteurs du monde. Sa
production, qui s'élevait à 4.570.000 tonnes en j
1938, se répartit pour 90 en Afrique du Nord
française, c'est-à-dire la Tunisie (2.034.000 tonnes),
le Maroc français (1.487.000 tonnes) et l'Algérie
(584.500 tonnes), tandis que l'Egypte ne produit
que 458.400 tonnes et la Nigérie 5.700 tonnes seu-
lement.
Les gisements de la Tunisie se trouvent répartis
en deux grandes régions : celle de Gafsa, au Sud,
à 200 kilomètres environ à l'ouest du port de Sfax,
et celle de Kalaa-Djerda, à l'ouest de la ville de
Tunis. Les gisements de Gafsa contiennent de 58 à
65 de phosphate de calcium, et ceux de Kalaa-
Djerda atteignent une proportion de 60 à 63
Les réserves sont évaluées à 1.500.000.000 de
tonnes environ. Les trois principales sociétés exploi -
tatrices sont la Compagnie des Phosphates et du
Chemin de fer de Gafsa, la Société des Phosphates
tunisiens et des Engrais et Produits chimiques, et
enfin la Compagnie tunisienne des Phosphates du
Djebel-Mdilla. La production tunisienne se trouve
seconde seulement à la production américaine. Les
mines de Metlaouï, où ont été faites les premières
extractions de phosphates de Tunisie, sont reliées au
port de Sfax par un chemin de fer d'une longueur
de 243 kilomètres. Les cinq puits de mines de Gafsa
ont produit depuis leur mise en exploitation plus de
45 millions de tonnes. Les phosphates s'y trouvent
sous forme de couches étendues et régulières, dont
l'épaisseur varie de 1 à 3,5 mètres. La production
de phosphates tunisiens est considérable. Elle a at-
teint son point maximum en 1930, avec 3,326.000
tonnes. Une usine pour la préparation des super-
phosphates se trouve à El-Afrance. Quant à la pro-
duction tunisienne, 90 environ sont absorbés par
la France, tandis que le reste, soit 10 %, est ex-
porté en Grande-Bretagne. Le nombre des travail-
leurs employés dans les mines de Tunis s'élève à
10.000. Depuis 1938, les producteurs de phospha-
tes se sont groupés en une Société tunisienne d'Etu-
des et de Coopération et de Défense de l'Industrie
des phosphates, dont le but est d'améliorer les chif-
fres de production et les procédés techniques de
l' extraction.
La production du Maroc français est très rap-
prochée de celle de Tunis. Le droit de prospection
et d'exploitation des phosphates y est devenu, de-
puis 1920, un monopole d'Etat et il est géré par
un Office chérifien des Phosphates. La production
marocaine, commencée en 1908, se concentre sur
les gisements très riches de Kourigha et de Gann-
tour. Les mines de Kourigha se trouvent près de la
voie ferrée allant à Casablanca, et les gisements,
évalués à 1 milliard de tonnes environ, contiennent
75 à 76 de phosphates de calcium. Les mines
de Gnantour. ouvertes en 1933, se trouvent près de
la gare de Ben Guérir, sur la voie ferrée allant de
Marrakech à Casablanca, et les gisements contien-
nent de 68 à 70 de phosphates, mais ils sont
moins riches que ceux de Kourigha, qui produisent
quatre cinquièmes de la production marocaine toute
entière. Les gisements de Kourigha et de Ganntour
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
-
-
Page
chiffre de pagination vue 13/36
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k64374721/f13.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k64374721/f13.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k64374721/f13.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k64374721
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k64374721
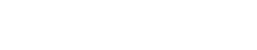


Facebook
Twitter