Titre : L'Agriculture pratique des pays chauds : bulletin du Jardin colonial et des jardins d'essai des colonies françaises
Auteur : Jardin d'agronomie tropicale (Paris). Auteur du texte
Auteur : France. Inspection générale de l'agriculture coloniale. Auteur du texte
Éditeur : A. Challamel (Paris)
Éditeur : Société d'éditions géographiques, maritimes et colonialesSociété d'éditions géographiques, maritimes et coloniales (Paris)
Date d'édition : 1912-04-01
Contributeur : Perrier, Edmond (1844-1921). Directeur de publication
Contributeur : Wery, Georges Eugène (1861-1936). Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34427633b
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 14345 Nombre total de vues : 14345
Description : 01 avril 1912 01 avril 1912
Description : 1912/04/01 (A12,N109)-1912/04/30. 1912/04/01 (A12,N109)-1912/04/30.
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k64197902
Source : CIRAD, 2012-231834
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 12/08/2013
284 ÉTUDES ET MÉMOIRES
sidèrent ces Champignons comme bien autonomes et que le second
en fait même une famille distincte, celle des Seuratiacées, Arnaud 1
pense que les Seuratia ne sont que de simples modifications
d'autres Pyrénomycètes, consistant en la gélification des parois
cellulaires. Cette dernière manière de voir demanderait à être con-
firmée ; la simple constatation faite par Arnaud de corps stériles à
structure seuratioïde au milieu des conceptacles de fumagine ne
suffit pas pour démontrer la dépendance de la première forme par
rapport à la seconde ; il peut fort bien s'agir d'espèces distinctes
mélangées, comme Vuillemin l'admet pour un cas analogue signalé
par Bernard (Capnodillln stellatum). D'ailleurs, quand bien même
certains Pyrénomycètes présenteraient, dans des circonstances à
déterminer, des modifications rappelant la structure des Seuratia,
il ne s'en suivrait pas nécessairement que ces derniers soient tou-
jours des anomalies d'autres espèces, à supprimer de la nomencla-
ture en tant que formes autonomes. Mais, pour l'instant, en atten-
dant que ces points soient élucidés, il y a lieu de conserver le
genre Seuratia pour les espèces dont nous avons à parler ici ; si en
effet ce ne sont que des formes modifiées d'autres Pyrénomycètes,
ceux-ci sont encore inconnus.
Le Seuratia coffeicola, rencontré d'abord par Patouillard sur les
feuilles du Caféier, a été retrouvé à Tahiti par son créateur sur un
grand nombre d'autres plantes, notamment sur le Vanillier. Je ne
reviendrai pas sur la description déjà donnée ici même de cette
espèce. J'ajouterai seulement à ce qui en a été dit que les exem-
plaires luxuriants peuvent atteindre un centimètre de diamètre et
ont l'aspect d'un thalle fruticuleux étalé en rosette sur la feuille ;
les rameaux sont simples, fourchus et irrégulièrement divisés ; les
asques sont groupés dans des renflements du thalle; le renflement
peut être unique et placé au centre de la rosette ; d'autres fois il y
a plusieurs renflements distribués sur les rameaux.
LeSëuratia Vanillse Pat. (fig. 24-28), spécial jusqu'ici à la Vanille
et rencontré seulement à Tahiti, a la même structure générale que
la précédente espèce ; mais ici le thalle est presque nul, tout se
réduit en quelque sorte à un périthèce (fig. 24-26) arrondi, de
1. ARNAUD, Contribution à l'étude des Fnmagines (Annales de l'École nationale
d'Agriculture de Montpellier, T série, t. IX, fasc. 4,1910, eL Annales Mycologici, VIII,
1910, p. 470).
sidèrent ces Champignons comme bien autonomes et que le second
en fait même une famille distincte, celle des Seuratiacées, Arnaud 1
pense que les Seuratia ne sont que de simples modifications
d'autres Pyrénomycètes, consistant en la gélification des parois
cellulaires. Cette dernière manière de voir demanderait à être con-
firmée ; la simple constatation faite par Arnaud de corps stériles à
structure seuratioïde au milieu des conceptacles de fumagine ne
suffit pas pour démontrer la dépendance de la première forme par
rapport à la seconde ; il peut fort bien s'agir d'espèces distinctes
mélangées, comme Vuillemin l'admet pour un cas analogue signalé
par Bernard (Capnodillln stellatum). D'ailleurs, quand bien même
certains Pyrénomycètes présenteraient, dans des circonstances à
déterminer, des modifications rappelant la structure des Seuratia,
il ne s'en suivrait pas nécessairement que ces derniers soient tou-
jours des anomalies d'autres espèces, à supprimer de la nomencla-
ture en tant que formes autonomes. Mais, pour l'instant, en atten-
dant que ces points soient élucidés, il y a lieu de conserver le
genre Seuratia pour les espèces dont nous avons à parler ici ; si en
effet ce ne sont que des formes modifiées d'autres Pyrénomycètes,
ceux-ci sont encore inconnus.
Le Seuratia coffeicola, rencontré d'abord par Patouillard sur les
feuilles du Caféier, a été retrouvé à Tahiti par son créateur sur un
grand nombre d'autres plantes, notamment sur le Vanillier. Je ne
reviendrai pas sur la description déjà donnée ici même de cette
espèce. J'ajouterai seulement à ce qui en a été dit que les exem-
plaires luxuriants peuvent atteindre un centimètre de diamètre et
ont l'aspect d'un thalle fruticuleux étalé en rosette sur la feuille ;
les rameaux sont simples, fourchus et irrégulièrement divisés ; les
asques sont groupés dans des renflements du thalle; le renflement
peut être unique et placé au centre de la rosette ; d'autres fois il y
a plusieurs renflements distribués sur les rameaux.
LeSëuratia Vanillse Pat. (fig. 24-28), spécial jusqu'ici à la Vanille
et rencontré seulement à Tahiti, a la même structure générale que
la précédente espèce ; mais ici le thalle est presque nul, tout se
réduit en quelque sorte à un périthèce (fig. 24-26) arrondi, de
1. ARNAUD, Contribution à l'étude des Fnmagines (Annales de l'École nationale
d'Agriculture de Montpellier, T série, t. IX, fasc. 4,1910, eL Annales Mycologici, VIII,
1910, p. 470).
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 99.96%.
- Auteurs similaires Indochine française Indochine française /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Indochine française" or dc.contributor adj "Indochine française")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 20/88
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k64197902/f20.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k64197902/f20.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k64197902/f20.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k64197902
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k64197902
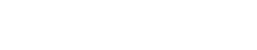


Facebook
Twitter