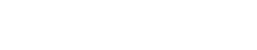Titre : Les Annales coloniales : organe de la "France coloniale moderne" / directeur : Marcel Ruedel
Auteur : France coloniale moderne. Auteur du texte
Éditeur : [s.n.] (Paris)
Éditeur : [s.n.][s.n.] (Paris)
Date d'édition : 1931-11-10
Contributeur : Ruedel, Marcel. Directeur de publication
Notice du catalogue : http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb32693410p
Type : texte texte
Type : publication en série imprimée publication en série imprimée
Langue : français
Format : Nombre total de vues : 11726 Nombre total de vues : 11726
Description : 10 novembre 1931 10 novembre 1931
Description : 1931/11/10 (A32,N152). 1931/11/10 (A32,N152).
Description : Collection numérique : Bibliothèque Francophone... Collection numérique : Bibliothèque Francophone Numérique
Description : Collection numérique : Numba, la bibliothèque... Collection numérique : Numba, la bibliothèque numérique du Cirad
Description : Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1 Appartient à l’ensemble documentaire : RfnHisg1
Description : Collection numérique : Protectorats et mandat... Collection numérique : Protectorats et mandat français
Description : Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique... Collection numérique : Bibliothèque Diplomatique Numérique
Droits : Consultable en ligne
Identifiant : ark:/12148/bpt6k63804223
Source : Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LC12-252
Conservation numérique : Bibliothèque nationale de France
Date de mise en ligne : 14/02/2013
TRENTE-DEUXIEME ANNEE. - NQ 152. LE NUMERO J 80 CENTIMES • MARDI SOIR, 10 NOVEMBRE 1931.
JOURNALJUOTIDIER
Rédaction & Administration :
UtÉièéiiiM-TkUir
PARIS a") 1
TÉUÉPH. s LOUVRB 1147
- RICHELIKU siffl
L 1 c 0
Les Annales Coloniales
tM MaonMt et réclames sont reçues au
bureau du Journal..
DIRECTBUR.FONDATEUR » Maroel RUID.L
M
Tous les articles publiés dans notre fournal ne peuvent
être reproduits qu'en citant les ANNALES CoLONIALU.
ABONNEMENTS
avec - la - Revue -- mensuelle : -----
Un de 6 Mois 8 Mol.
France et
Colonies 180 » 100 > 50 ̃
Étranger. 240 » 126 » 70 »
On s'abonne sans trais daru
tous les bureaux de poste.
L'école tes Arts canbodilens
à Pnom-Penli
Les Indochinois se sont primitivement
inspirés des œuvres d'art de la Chine.
Plus tard, tout en conservant les mêmes
principes, ils ont développé normalement
cet art d'une manière très intéressante, en
particulier entre le xve et le XVIIIe siècle, épo-
que à laquelle ils ont laissé de nombreuses
œuvres marquant les moments heureux de
la vie artistique indochinoise.
Peu à peu, leurs conceptions architectura-
les et leurs dispositions décoratives ont su
trouver leur expression définitive d'une forte
originalité dont nous pouvons avoir une
idée à l'Exposition Coloniale par la repro-
duction du Temple d'Angkor Vat, le plus
beau spécimen de l'art kmer qui subsiste
au - Cambodge.
Nous demeurons étonnés par l'ampleur,
la majesté, l'harmonie de ses masses, la
netteté de ses lignes, la grâce et l'élégance
de ses dômes, la verticalité de ses escaliers
monumentaux.
La conception et la construction du vrai
temple, quatre fois plus grand, à une épo-
que si ancienne, dépasse notre imagination,
soulève en nous l'admiration sans borne
pour les artistes qui, par leur patients
efforts, ont réussi à faire un tel chef-d'œu-
yre.
En dehors de l'architecture, dans la
sculpture, le bronze, la céramique et la bro-
derie, les Indochinois excellaient aussi,
mais au cours des siècles, des causes. multi-
ples, guerres, infortunes politiques, influen-
ces occidentales et en particulier l'influence
française ont altéré le caractère original de
leurs productions artistiques. --
1.1 faut reconnaître, en effet, que c est
depuis notre arrivée dans la colonie que les
Annamites, ont adopté avec empressement,
dans tous les domaines de l'activité, nos
goûts, nos méthodes, nos pensées. Man-
quant de direction, ayant perdu la foi en
leurs anciens maîtres, ils ont cru bien faire
de mépriser et de délaisser leurs traditions
ancestrales.
Aussi pour sauver leur art, la France
a-t-elle envisagé de faire un enseignement
Artistique en Indochine,
Pour l'art cambodgien en particulier, le
Protectorat estima qu'il suffirait de mettre
en contact avec l'artisan habite des appren-
tis de bonne volonté., dans des conditions
pratiques, à peu â. identiques j à «telles qui
étaient téatiséès jarlis, qui s étaient poursui-
y-les pendant des siècles, pour que la trans-
mission de cet art s'opérât encore.
• Il fallait donc tout d'abord retrouver,
réunir et conserver les formes antérieures
de l'art local, témoins de la tradition artis-
tique khmèje, guides et modèles pour l'avenir
puis faire dans tout le Cambodge le recen-
sement des artisans encore existants prati-
quant une industrie l'art quelconque et
choisir parmi les plus habiles d'entre eux
les maîtres qualifiés pour enseigner leur
technique. Il fallait enfin assurer aux pro-
ductions de cette main-d'œuvre un écoule-
ment suffisant, d'où la nécessité pour le
protectorat de créer une organisation répon-
dant à ces divers besoins.
L'école des Arts cambodgiens à Pnom-
Penh répond à ces conditions.
Elle comprend un musée qui conserve et
maintient présente la tradition locale; l'éco-
le qui forme des artisans en liaison étroite
avec cette tradition et continuant ses pro-
cédés, l'Office de ventes assurant à la pro-
duction les débouchés nécessaires et la vie
matérielle des artisans formés. -
* Des maîtres artisans désignés par l'opi-
nion indigène et qui avaient fait leurs preu-
ves. furent recrutés et nommés chefs d'ate-
lier. On leur donna l'outillage qu'il's de-
mandaient et qui était leur outillage tra-
ditionnel. En quelques mois, l'école était
créée par une agrégation naturelle. Depuis
io ans, elle fonctionne de la même manière.
Ses méthodes pédagogiques sont indigènes
et répondent par conséquent au tempérament
des individus et à la nature de l'art ensei-
gné. Elites sont à l'abri de l'influence fran-
çaise et naturellement soumises à l'évolu-
tion de la race et aux influences du milieu.
Au cours des premières années cet ensei-
ngement donné librement en cambodgien,
tel que 50 oubioo ans plus tôt dans les
villages ou les monastères, sans heurter au-
cune habitude, permit à la direction fran-
çaise, plutôt spectatrice et observatrice que
dirigeante, d'étudier l'art qu'elle voùlait
faire revivre et d'assister à sa mise en pra-
tique historique et naturelle,
A l'entrée, rien n'est exigé du candidat,
tinon qu'il ait 14 à 15 ans, sache lire et
écrire sa langue, sans exiger le français.
Il doit fréquenter l'école « en période
d'observation » et quand une place cPap.
prenti est libre, la direction y nomme le
meilleur et non pas le plus ancien des as-
pirants.
Observé par son patron et par. la direc-
tion française, s'il se montre inactif et ne
progresse pas, il est renvoyé immédiatement.
Au contraire, s'il est bien doué, actif, au-
cun délai fixe ne retarde sa carrière scolaire
et il est libre quand il le veut cPexécuter son
uvre de sortie. S'il réussit, il peut
pa-rfu, diplôme en poche, sinon il reste et
a droit encore à un essai.
Jamais d'examen, jamais de classement
tans valeur sur le tempérament Cambodgien,
mais, des primes scolaires proportionnées à
la valeur générale de l'individu (3, 4, 5
piastres par mois).
En pratique un artisan n'est formé qu'a-
près un minimum de deux ans et demi.
Une vingtaine d'élèves sortent chaque an-
née diplômés « artisans P, 40 à 50 autres
en moyenne sont renvoyés pour insuffisance
de travail, ce qui prouve qu'une sélection
sérieuse de l'apprenti est faite.
Celui-ci, presque formé, à la veille de
sa libération collabore avec le patron qui
fait le même travail. C'est du travail ef-
fectué par les mains les plus habiles que
sortent des types de décors, d'objets de tou-
tes sortes et de toute nature qui concré-
tisent l'enseignement. Ce répertoire des piè-
ces canoniques de l'art kmer marque le
« moment » de*l'art ; elles restent au musée
de l'Ecole qui constitue le musée national.
L'école ne doit produire dans chaque spé-
cialité qu un nombre d artisans déterminé
pour le pouvoir d'achat de la clientèle. Tout
çhômage, toute erreur doivent être évités, et
jl doit en somme y avoir une certaine rare-
té des œuvres d'art mises en circulation pour
conserver le prestige des artisans. La màln-
d'œuvre susceptible de se former en dehors
de ses ateliers peut le faire librement.
Si nous considérons que dans le plan ar-
tistique kmer, la main-d'œuvre seule compte,
l'enseignement - est - appelé à se prolonger
et aussi l'exécution de I'oeuvre, mais ce
maintien du travail purement manuel est
une garantie que par sa manière et sa for-
me, elle sera différente de ce qui se fait en
Europe et d'autant plus intéressante.
L'école assure donc le contrôle artisti-
que, la probité et la pureté de ses produc-
tions et leur écoulement à une clientèle for-
mée en grande partie de touristes qui vi-
sitent Pnom-Penh, formée aussi de Cam-
bodgiens riches qui reviennent au- goOt de
leur art national.
A l'Exposition coloniale, à la pagode du
Cambodge se trouvent de curieuses et ma-
gnifiques pièces d'orfèvrerie, de sculpture,
de fonte, de tissage exécutées par des élè-
ves de différentes écoles d'art indochinoîs.
Nous ne pouvons que rendre hommage
à ceux qui ont eu l'idée de créer ces éco-
les en Indochine et aux maîtres qui ont su
si bien les faire.. produire. Quant à la
rénovation de l'artisanat kmer, elle est au-
jourd'hui un fait accompli qui permet les
plus grands espoirs et est l'une des plus
intéressantes réussites de l'enseignement
technique en Indochine. - -1 - - -
Camille Briquet,
Député de l'Eure. Secrétaire de la Com-
mission de VAlgérie, des Colonies, et
des Protectorats.
.t..
En regardant une gravure
«»«
C'est une photo reproduite par le bulletin
d'un office international i
Sur un amoncellement inextricable de
têtes coupées et de cadavres de zèbres, un
chasseur est assis.
Casque sur l'oreille et pipe aux dents,
l'homme est triomphant. Il a battu la brous-
se une journée ; et dans la clairière, au pied
d'un arbre, voici le monstrueux trophée..
Il peut faire, et, peut-être, a-t-il déjà fait
rêver plus d'un Nemrod et même provoqué
le départ d'une troupe de massacreurs. Car
vers l'Afrique équatoriale, vers le Congo bel-
ge et plus loin, le Sahara offre aujourd'hui
des pistes parfaitement repérées, et les rou-
tes du ciel sont encore beaucoup plus libres.
Quiconque n'a pas la bourse trop plate peut
s'offrir en allant là-bas des émotions cynégé-
tiques particulièrement intenses.
Mais, est-il possible de rester indifférent
devant des destructions inutiles ?
Il y a trente ans, à Kayes, -on chassait le
canard en plein village indigène, et la grosse
bête aux environs immédiats de la ville. Il
en était de même dans tous les centres ha-
bités. Aujourd'hui il faut des randonnées de
cent kilomètres pour tirer un rat palmiste
En 1925, TOubangui exporta 50.000 kilos
d'ivoire.
En 1929, les sorties se réduisirent à 30.000
kilos.
Elles ne furent que de 16.000 en 1930.
Depuis que l'Afrique est l'Afrique, l'hom-
me sauvage et la bête ont vécu dans un étroit
voisinage, sans que celui-là, mangeur pour-
tant redoutable, soit parvenu à menacer
l'existence de celle-ci. La Nature avait, entre
eux, comme fixé un équilibre.
Un jour arriva l'homme blanc ; et voici,
en quelques années, les espèces animales
menacées de disparition.
Qui, chez nous, s'en préoccupe comme il
le faudrait ?
Et pourtant, en cette époque d'affaires et
de mercantilisme, il conviendrait de ne 'pas
oublier que nos commerçants du Congo ont
réalisé, grâce aux éléphants, des bénéfices
par millions, et que c'est dans la vente des
peaux de singes que les petits planteurs de
là Côte d'Ivoire ont trouvé, pour parer aux
effets de la crise, l'appoint qui leur était né-
cessaire. -
Voilà pour nos réalistes.
Pour les autres, rêveurs beaucoup plus
près de la réalité, comme tous les rêveurs,
et qui croient que la civilisation, comme la
vie elle-même n'est qu'une somme d'harmo-
nies, il reste que nous avons des devoirs en-
vers les bêtes.
L'Angleterre et la Belgique- y ont déjà
pensé. Elles ont créé dans leurs vastes do-
maines africains des réserves où viennent se
mettre à l'abri les aninaux traqués.
Mais nous arrivons bons demleTs.
C'est donc avec raison que le Gouverneur
général de l'A.E.F. a promulgué le décret
réglant les conditions de la chasse et arrête
le modalités de son application.
Son initiative a fçit des mécontents.
N'est-ce pas la preuve que lui-même a bien
fait ?
P..c. Ctwfw Français,
Gouverneur ivnowft fin Coionui.
Un regard sur Tahiti
-
J < h i t -" J
E Bulletin du Com-
merce de la Nou-
velle - Calédonie et
des Nouvelles-Hé-
brides du 18 juillet
1931 appelait l'at.
tention de la France
sur Tahiti,
Cette possession
française de l'Océqn
Pacifiaue mérite en
effet que la Métropole conserve l'oeil ou-
vert sur elle en raison des convoitises étran-
gères, de la mainmise de plus en plus resser-
rée et de la politique d'influence pratiquée
avec habileté par les Etats-Unis,
Les Etablissements français de l'Océanie)
dont, l'île Tahiti est la clé de voûte, sont
comme les autres pays dans une période de
dépression économique profonde. Tahiti de-
mande des mesures de protection.
C'est l'état général de nos colonies actuel-
lement, parce que si l'Europe et. les Etats-
Unis sont frappés lourdement par la crise
économique, les Colonies ne sont pas épar-
gnées.
- Demander à la mère-patrie des mesures
de protection 'est chose facile, mais reste va..
gue. Un programme de défense économique
bien établi vaudrait mieux. Tahiti réclame
un Conseil représentatif pour faire entendre
sa voix et préconiser des mesures de salut.
On peut accepter cette idée, mais il ne fau-
drait pas que les Tahitiens pensent qu'il suf -
fira d'un Conseil général pour ramener la
prospérité dans l'île.
En attendant, on peut croire que le mieux
serait que Tahiti élabore dès maintenant un
programme de restauration qui soit soumis
ait Gouvernement français.
Ch. Debierre,
Sénateur du Nord,
Membre de 14 commission
Sénatoriale des Allaires Etrangères.
ofte-
M. Lucien Saint
est rentré à Rabat
*♦«
M. Lucien Saint, résident général de Fran-
ce au Maroc, accompagné du chef de son ca-
binet militaire, le commandant Juin, est arri-
vé à Tanger, vendredi soir.
Il a regagné Rabat par la route, samedi.
Echange de télégrammes
En -quittant -le -téftttoira espagnol* le îwl-
dent général à tenu à exprimer à M. Herbette,
ambassadeur à Madrid, ses remerciements pour
l'accueil que lui a réservé l'ambassade.
M. Herbette lui a répondu dans les termes
suivants:
Profondément sensible à votre cordial télé-
gramme, je vous remercie du souvenir que vous
avez bien voulu garder de notre accueil et je
vous félicite encore du précieux ouvrage que
Vous avez fait ici pour développer entre les
Républiques espagnole et française celle ami-
lié qui me tient tellement à cœur.
M. Lucien Saint a adressé à M. Azana, pré-
sident du gouvernement de la République es-
pagnole le télégramme suivant :
Avant de quitter l'Espagne pour rejoindre
mon poste, je tiens à Vous exprimer mes remer-
ciements émus pour toutes les attentions déli-
cates dont j'ai été l'objet à Madrid de la part
du gouvernement de la République espa-
gnole.
J'emporte des entretiens cordiaux que j'ai
eus avec vous et vos éminents collaborateurs,
l'impression d'une amitié sans cesse plus étroi-
te et d'une parfaite unité de vues sur r œuvre
marocaine à laquelle l'Espagne et la France
s'emploient d'un mme cœur et dans un esprit
de loyale et confiante collaboration.
M. Azana a répondu :
Je vous remercie de votre télégramme et,
avec ma haute considération et mon amitié, je
tiens à vous renouveler le désir du gouverne-
ment de la République espagnole de maintenir
sans cesse avec la France une étroite collabo-
ration loyale et confiante dans l'œuvre maro-
caine.
-Me-
nLjpART
868
M. Ponsot rejoint son poste
M. Henri Ponsot, haut commissaire de la
République en Syrie et au Liban, et Mme
Ponsot sont partis de Paris hier pour Mar-
seille où ils s'embarquent aujourd'hui à
destination de Beyrouth. Le haut commis'
saire, au cours de son séjour à Paris, a pu
examiner et mettre au point les différents
problèmes qui se réfèrent à notre action au
Levant. On se rappelle qu'au cours de la
session de septembre dernier, la Commission
des mandats de la Société a donné son ap-
probation à l'œuvre accomplie par le repré-
sentant de la France en Syrie.
M. Ponsot a été saï&é à la gare de Lyon
par M. de Saint-Quentin, représentant M.
Briand, M. Pierre-Alype, délégué à Paris du
haut commissariat de la République en Sy-
rie, et par de nombreuses personnalités du
monde diplomatique.
En même temps que M. Ponsot, sont par-
lis ; M. Tetreau, secrétaire général du haut
commissariat ; M. Solomiac, délégué à Da-
mas; M. Neyrac, attaché au cabinet, et les
capitaines Terrier et Lauras.
A 1-1 natitut
I
Vacance de fauteuil
-- Il'' 11 1
Dam leur dernière réunion les membres de
l'Institut ont déclaré vacant le fauteuil du re-
gretté architecte Deglane, dont le successeur
sera élu le 28 novembre.
A la Sorbonne
Une belle leçon coloniale
Décidément, il y a quelque chose de
changé, les cloisons ont sauté et la France
(Poutre-mer pénètre jusqu'au cœur de l'anti-
que fondation de Robert de Sonbon.
Certes, nous sommes loin du temps où
l'Université de Paris s'abritait dans les
vieilles masures de la Montagne-Sainte-Ge-
neviève, concédées par le roi Saint-Louis à
son chapelain.
En cette séance solennelle de rentrée, M.
Paul Doumer, président de la République;
M. Mario Roustan, ministre de l'Instruction
publique; M. Charléty, recteur et les mem-
bres du Corps universitaire ne s'assirent pas
sur les escabeaux de bois des maîtres du
moyen âge, près des bottes de paille réser-
vées aux élèves.
Confortablement tnstallée dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, l'éminente as-
sistance put apprécier le magistral discours
de M. Charléty, gonflé par les vents du
large qui nous apporte, des cinq parties du
monde, le visage de la France intégrale.
Le premier devoi** des Universités est, en
effet, d'indiquer le changement d'échelle des
problèmes de notre temps et de former les
jeunes hommes qui se trouveront demain en
face d'un empire.
Voici quelques passages de ce discours
qui élargit singulièrement la vision de ceux
qui, un jour prochain, peuvent commander
aux destinées de la plus grande France :
« Le Français, quelle que soit sa condi-
tion, ne vit plus ignorant, replié et satisfait.
Une porte est enfoncée. Le vigneron du Midi
surveille non sans inquiétude celui de l'Afri-
que du Nord. Il y a des villes dont la po-
pulation oscille d'une dizaine de mille âmes
suivant le cours du caoutchouc ; et l'on y
sait que le phénomène a son origine dans
l'Asie tropicale. Toute notre vie est envahie
de sensations étrangères. Voilà beau temps
que le Savoyard et sa marmotte ont été rem-
placés dans les types populaires de la rue
par le ,Kabyle et ses tgipis. Le bétail du
Nord consomme du manioc de Madagascar
et nous mangeons autant de bananes que de
pommes. L'essence de votre voiture vient de
partout sauf de chez nous. Il faudrait être
sourd pour épargner à ses oreilles la plus
redoutable des importations celle de la mu-
sique nègre. »
,. l' Il.
« Ainsi le phénomène colonial nous paraît
aujourd'hui le phénomène central de - l'his-
toire du monde. Notre part y est belle. Nous
l'avons conquise un peu par inadvertance ;
et c'est un échantillonnage magnifique de la
planète. Mais le jeune Français moyen le
sait-il bien et le croit-il consciemment à
cette heure? Il semble qu'il se méfie : pour-
tant il est obscurément troublé. Il va a l'Ex-
position et on lui dit que pareil succès ne
s'était'-pas ifit-éetrois la dernière Exposition
universelle, il y a trente et un ans. -11 sent
confusément que colonial et universel sont
devenus synonymes. »
M. Charléty rendant hommage à l'admi-
nistrateur civil colonial, ajoute :
« Métier admirable qui s'empare de tout
l'homme parce qu'il le forme, lui laissant de
l'initiative et des responsabilités. A-t-il chez
nous le retentissement qu'il devrait avoir ?
Donnons-nous à notre excellente école colo-
niale qui les éduque tout ce que nous pour-
rions lui offrir de valeurs désireuses de se
soustraire aux routines, aux misères, à
l'usure de l'administration métropolitaine ?
Placée devant les magnificences et les dan-
gers de notre empire, notre jeunesse, notre
élite morale et scientifique en doit acquérir
clairement le souci. Quel est celui de nos étu-
diants qui rêve d'être le grand chef futur,
après une carrière impériale?
« C'est en pensant à ce jeune Français,
monsieur le Président de la République, que
je vous apporte la respectueuse reconnais-
sance de l'Université. Votre présence nous
est chère; elle nous rappelle l'amicale bien-
veillance du Président du Sénat que le chef
de l'Etat veut bien ne pas oublier.
« C'est pourquoi, ayant fait, comme tout le
monde, une promenade à l'Exposition Colo-
niale, ayant comme tout le monde lu quel-
ques beaux livres, d'aujourd'hui dont l'un
accable de remords les historiens que nous
sommes, j'ai cru pouvoir proposer à votre
habituelle indulgence cette sévère et peut-
être indiscrète méditation. »
Le discours de M. Charléty a été chaleu-
reusement applaudi. Puisse-t-il porter ses
fruits dans toutes les allées de la riante Cité
universitaire où déjà, le dragon, le lotus et
bien d'autres totems planétaires sont
comme chez eux.
M.-L. Si
A la Société des Nations
La Commission des Mandats
La Commission des mandats a examiné
hier lundi le rapport annuel du gouverne-
ment français sur l'administration du Togo,
placé sous son mandat, en piésence de M.
Besson chef du premier bureau du départe-
ment politique du ministère des Colonies.
Après avoir remercié la puissance manda-
taire des renseignements fournis dans son
rapport, le président de la Commission a
rappelé une question qui avait été soulevée
lors de la précédente session, en ce qui
cohcèrne la délimitation des frontières du
- Togo.
La Commission a demandé des renseigne-
ments au représentant accrédité sur diffé-
rents points. Elle s'est occupée également
des finances du territoire et de la situation
du pays, au point de vue commercial.
En ce qui concerne les conditions du tra-
vail au Togo, le représentant accrédité a dé-
claré que l'administration offre des salaires
suffisamment élevés pour recruter une main-
d'œuvre suffisante pour les besoins des tra-
vaux publics. Aucune réquisition des travail-
leurs n'est permise au Togo, en vue de
l'entreprise privée.
Enfin, le représentant accrédité a énu-
méré les efforts accomplis par la puissance
mandataire, en vue de faire face aux besoins
sanitaires du pays, notamment dans la lutte
contre la lèpre et la maladie du sommeil.
le Sénégal en 1931
.t.
A quoi sert le manioc
cu J'ai dans un précédent article: traité de la
culture du manioc.
Je vais aujourd'hui essayer de donner quel-
que aperçu sur les nombreux et utiles emplois
de sa racine.
Lorsque la farine de manioc ne doit pas
être consommée presque immédiatement, on la
convertit en couac et en cassave.
Le-couac qui peut être jaune ou blanc, s'ob-
tient, en jetant la farine humide et salée sur
une plaque chauffée, et en la faisant passer
dans un tamis à mailles assez grosses. La pla-
que chauffée est en tôle ou eu.. fonte, et ma-
çonnée généralement sur un fourneau alimenté
au bois. La cuisson ne doit pas dépasser un
certai n degré, et, pour que la farine n'adhère
pas à la plaque, il faut la remuer sans cesse
avec une palette ou un râteau en bois, et ce-
pendant tout le temps de la cuisson. Cette fa-
rine se conserve très longtemps si on la met
dans un endroit sec, et s'emploie comme la
farine fratche.
Pour la cassave, la farine de manioc doit
être plus finement tamisée que pour le couac.
Elle est convertie en galettes, fines ou en crê-
pes en employant le même mode de procéder
que pour le couac, seulement au lieu de re-
muer la farine sur la plaque pendant toute la
durée delà cuisson, on l'étale circulairement,
et on lui fait subir une certaine pression, pour
que toute la masse s' agrège. On retourne la
galette ou la crêpe deux ou trois fois pour
qu'elle soit bien cuite.
La cassave se'conserve comme le couac et
aussi longtemps.
Du liquide laiteux qui s'est écoulé pendant
la préparation de la farine, et qu'on laisse re-
poser, on tire une fécule très fine qui est usitée
comme empois. Cuite au four, elle peut, si
on le veut, être employée pour faire, comme
au Brésil, des gâteaux fins très appréciés là-
bas. Si on la met en bouillie légère, elle de-
vient un aliment très reconstituant pour les en-
fants et les convalescents. Enfin, avec cet ami-
don on fait le tapioca.
Pour obtenir celui-ci en grande quantité et
industriellement, il faut préparer spécialement
les tubercules de variétés à grand rendement.
Le plan général d'une usine à tapioca est,
grosso modo, le même que celuj d'une fécule-
rie de pommes de terre. Il y a cependant quel-
,. il y a
ques modifications : elles portent surtout sur
les râpes qui doivent être bien plus fortes et
robustes pour les tubercules de manioc, fer-
mes et résistants, que pour les ponimes de terre.
Pour être convertie en tapioca, la fécule est
cuite et granulée. Elfe passe par pression à
travers un tamis et tombe sur une surface chauf-
fée à 1500. Au contact de cette- surface, les
grains d'amidon se dextrinisent, et s agglo-
mèrent en grumeaux plus ou moins gros. Ces
grumeaux sont désséchés à l'étuve, concassés
et classés de façon à former finalement des
granules de grosseur uniforme.
Telle est, dans ses très grandes lignes la
fabrication du tapioca. On le prépare surtout
au Brésil, à Singapour et un peu à Madagascar
et à la Réunion. Il serait très souhaitable
qu'une ou plusieurs usines de ce genre se
créent au Sénégal, conjointement avec des
plantations industrielles de manioc, dont elles
seraient le complément tout indiqué. Ce se-
rait Une utilisation de leur récolte, infiniment
plus intéressante pour ces plantations, que
l'envoi qu'elles font en France actuellement
des cossettes séchées qu' elles expédient à
Marseille, où elles sont achetées depuis quel-
ques mois à un prix qui ne couvre même pas
les frais de culture et de transport.
Les industriels se lançant dans une exploita-
tion de ce genre, bénéficieraient pour la vente
de leur produit, du bon marché relatif de la
main-d' œuvre locale, de la facilité avec la-
quelle on la recrute, dans certains cantons,
tout au moins, et surtout de la proximité de la
France. On économiserait des frais de trans-
port considérables. Or on sait l'importance
de ce facteur dans l'établissement des prix de
revient actuels.
Naturellement, pour créer semblable indus-
trie il faut: la grande plantation, avec un ma-
tériel de culture mécanique approprié pour les
opérations qui peuvent se pratiquer ainsi, tel
au moins le labour ; l'eau en quantité suffi-
sante et de qualité permettant la création de la
féculerie. Enfin, la proximité d'un port, ou, à
défaut, d'une ligne de chemin de fer. Mais le
port est de beaucoup préférable, le fret par
eau étant - bien moins cher. Enfin, n'oublions
pas que si on a de 1 eau en quantité suffisante,
on peut, comme nous l'avons déjà dit, planter
le manioc toute l'année. On voit, sans qu'il
soit besoin d'insister, l'avantage qui peut dé-
couler de cette facilité de travail, et quelle
augmentation de rendement on peut espérer.
Ce serait aussi pour la colonie une source
de richesse économique nouvelle qui viendrait
singulièrement à point. -
Ainsi comprise, la culture du manioc four-
nirait aux indigènes une alimentation écono-
mique et excellente. Elle deviendrait pour les
européens disposant d'une plantation impor-
tante, menée avec intelligence, et ayant de
l'eau en quantité suffisante pour organiser une
féculerie, une source très probablement assurée
de bénéfices : pour la colonie, il serait inté-
ressant d'avoir une nouvelle corde à son arc,
en voyant se créer yne industrie susceptible de
fournir des matières à exporter.
Tout le monde y trouverait son compte.
Louu Le Barbier.
LIRE EN SECONDE PAGE :
ArExpositioncoloTdatc.
L'Aviation coloniale.
A la Chambre.
Répertoire de l'Officiel.
Un concours agricole
au Gabon
1..
Le concours agricole avec Foires-Expositions
organisé par le lieutenant-gouverneur du
Gabon, eut lieu récemment dans trois grands
centres de la colonie : Libreville, Port-oon-
til et Lambaréné. La manifestation fut sui-
vie avec un réel intérêt par les populations
européenne et indigène, qui comprirent l'im-
portance du développement agricole du pays.
Pour les cultures maraîchères, la production
pendant la saison sèche, permet maintenant
de satisfaire les besoins de la population de
Libreville et d'approvisionner en partie les
vapeurs de charge de passage.
Le développement des cultures potagères
est remarquable ; certains indigènes devien-
nent de véritables maraîchers dirigeant un
grand nombre de manœuvres et s associant
parfois dans les achats de semences pour le&
cultures et la vente des légumes. Générale-
ment, les indigènes possèdent surtout un pe-
tit jardin familial dont l'excédent vendu sur
le marché constitue des sources supplémen-
taires appréciables de revenus. Concernant
l'élevage, on constate l'amélioration des ra.
ces autochtones. Les efforts de l'administra-
tion tendent maintenant à introduire des es-
pèces nouvelles afin de varier la nourriture
des indigènes. Les semences légumineuses
riches en azote seront notamment distribuées.
Comme les années précédentes, la section
économique domestique réunit de nombreux
exposants. L'Exposition d'ameublement ré-
véla que les indigènes sont capables de fa-
briquer de beaux meubles.
Au concours agricole du Gabon, grâce aux
crédits délégués par M. le gouverneur géné-
ral Antonetti, les primes données en récom-
pense furent plus importantes que les an-
nées précédentes. Les animaux reproducteurs
sélectionnés de basse-cour, importés de
France, furent répartis entre les exposants,
surtout Européens, ceux-ci étant encore les
seuls, susceptibles de donner à ces animaux
les soins nécessaires à leur acclimatement.
Les produits de croisement obtenus avec
ceux des précédents concours, engagent
les producteurs à persévérer dans cette voie.
Afin d'améliorer les porcins du pays, mal
conformés, les couples issus des porcs yorks-
hire importés l'an dernier, furent répartis
entre les éleveurs importants. Les instru-
ments d'outillage furent remis aux jardi-
niers méritants.
A la section de Port-Gentil, l'échantillon
de pétrole brut exposé par la mission pétroll-
fère obtint un vif succès. Les produits de
chasse furent tirs nombreux cette année ; les
circonscriptions voisines participèrent à cette
manifestation. Signalons la présentation de
deux jeunes éléphants âgés de neuf mois. De
grosses quantités de poissons furent expo-
sées : le lamantin occupait la place d'hon-
neur.
La section agricole de Sambaréné permit
de constater les efforts déployés par les in-
digènes pour varier et accroître les produc-
tions ouvrière et industrielle. La culture du
poivre, entrepi ise depuis plusieurs années,
sera développée. Les produits d'élevage fu-
rent exposés en grand nombre. Le concours
agricole a créé une émulation croissante. Il
est d'un haut intérêt économique. ; les indi-
gènes comprennent la portée de cette mani-
festation.
.,.
La lutte contre les acridiens
On signale au Tchad un nouvel élément
de destruction des acridiens : coléoptère dont
l'aspect rappelle celui d'un petit scarabée et
que les indigènes nomment goudgoud en
Fezzajiais, tchoutgouda en (Kenembou et en
Gorane. Ces insectes attaquent les œufs de
sauterelles dont ils font une consommation
formi'l;,blc, et seraient abondants cette an-
née, contrairement à l'an dernier.
Les piastres sortent des bas
de laine indochinois
»♦«
On signale depuis quelque temps en In-
dochine qu'on voit affluer aux guichets des
banques et dans les boutiques, des piastres
souillées de terre, piastres métalliques aussi
bien que piastres en papier des plus vieux
modèles.
Leur origine se voit aisément.
Elles sortent des trous où les indigènes les
conservaient, selon une habitude bien
connue.
Un journal de Saigon fait remarquer que
s'il est d'une bonne économie politique que
l'argent roule, c'est à condition de revenir
à son point de départ et grossi comme la
boule de neige.
Or, dans le cas qui nous occupe, c'est ce
retour rémunérateur qu'on n'aperçoit pas. Si
les thésauriseurs se démunissent, c'est qu'ils
attaquent leurs réserves à un moment où ils
ne peuvent plus, par un travail régulier, se
procurer les sommes nécessaires aux dépen-
ses do la vie courante.
Ce symptôme n'est évidemment pa- rassu-
rant.
Nous le rapprochons d'un autie fait du
même ordre que nous avons signalé ici mê-
me la vente, toujours par les indigènes
pressés par le besoin, de titres de rente long-
temps restés en leur possession, et ratlés à
bas prix par des Chcttys et autres usuriers
sans conscience. Ici, la Banque rke l'Indo-
chine a pu arrêter le louche trafic, en rache-
tant les titres en question au cours du jour.
L'indigène a évité ainsi de grosses pertes.
Mais n'est-ce pas un symptôme aussi de la
situation économique actuelle, que connaît
notre grande colonie de l'Extrême-Orient,
comme d'ailleurs toutes les autres:
L'explorateur Norden est mort
1 1
L'explorateur américain TTermann Norden,
célèbre auteur et conférencier, vient de mou-
rir subitement à Londres, dans la rue. M.
Xordcn est l'auteur d'ouvrages Fur l'Indo-
chine, l'Annam et l'Océanie.
JOURNALJUOTIDIER
Rédaction & Administration :
UtÉièéiiiM-TkUir
PARIS a") 1
TÉUÉPH. s LOUVRB 1147
- RICHELIKU siffl
L 1 c 0
Les Annales Coloniales
tM MaonMt et réclames sont reçues au
bureau du Journal..
DIRECTBUR.FONDATEUR » Maroel RUID.L
M
Tous les articles publiés dans notre fournal ne peuvent
être reproduits qu'en citant les ANNALES CoLONIALU.
ABONNEMENTS
avec - la - Revue -- mensuelle : -----
Un de 6 Mois 8 Mol.
France et
Colonies 180 » 100 > 50 ̃
Étranger. 240 » 126 » 70 »
On s'abonne sans trais daru
tous les bureaux de poste.
L'école tes Arts canbodilens
à Pnom-Penli
Les Indochinois se sont primitivement
inspirés des œuvres d'art de la Chine.
Plus tard, tout en conservant les mêmes
principes, ils ont développé normalement
cet art d'une manière très intéressante, en
particulier entre le xve et le XVIIIe siècle, épo-
que à laquelle ils ont laissé de nombreuses
œuvres marquant les moments heureux de
la vie artistique indochinoise.
Peu à peu, leurs conceptions architectura-
les et leurs dispositions décoratives ont su
trouver leur expression définitive d'une forte
originalité dont nous pouvons avoir une
idée à l'Exposition Coloniale par la repro-
duction du Temple d'Angkor Vat, le plus
beau spécimen de l'art kmer qui subsiste
au - Cambodge.
Nous demeurons étonnés par l'ampleur,
la majesté, l'harmonie de ses masses, la
netteté de ses lignes, la grâce et l'élégance
de ses dômes, la verticalité de ses escaliers
monumentaux.
La conception et la construction du vrai
temple, quatre fois plus grand, à une épo-
que si ancienne, dépasse notre imagination,
soulève en nous l'admiration sans borne
pour les artistes qui, par leur patients
efforts, ont réussi à faire un tel chef-d'œu-
yre.
En dehors de l'architecture, dans la
sculpture, le bronze, la céramique et la bro-
derie, les Indochinois excellaient aussi,
mais au cours des siècles, des causes. multi-
ples, guerres, infortunes politiques, influen-
ces occidentales et en particulier l'influence
française ont altéré le caractère original de
leurs productions artistiques. --
1.1 faut reconnaître, en effet, que c est
depuis notre arrivée dans la colonie que les
Annamites, ont adopté avec empressement,
dans tous les domaines de l'activité, nos
goûts, nos méthodes, nos pensées. Man-
quant de direction, ayant perdu la foi en
leurs anciens maîtres, ils ont cru bien faire
de mépriser et de délaisser leurs traditions
ancestrales.
Aussi pour sauver leur art, la France
a-t-elle envisagé de faire un enseignement
Artistique en Indochine,
Pour l'art cambodgien en particulier, le
Protectorat estima qu'il suffirait de mettre
en contact avec l'artisan habite des appren-
tis de bonne volonté., dans des conditions
pratiques, à peu â. identiques j à «telles qui
étaient téatiséès jarlis, qui s étaient poursui-
y-les pendant des siècles, pour que la trans-
mission de cet art s'opérât encore.
• Il fallait donc tout d'abord retrouver,
réunir et conserver les formes antérieures
de l'art local, témoins de la tradition artis-
tique khmèje, guides et modèles pour l'avenir
puis faire dans tout le Cambodge le recen-
sement des artisans encore existants prati-
quant une industrie l'art quelconque et
choisir parmi les plus habiles d'entre eux
les maîtres qualifiés pour enseigner leur
technique. Il fallait enfin assurer aux pro-
ductions de cette main-d'œuvre un écoule-
ment suffisant, d'où la nécessité pour le
protectorat de créer une organisation répon-
dant à ces divers besoins.
L'école des Arts cambodgiens à Pnom-
Penh répond à ces conditions.
Elle comprend un musée qui conserve et
maintient présente la tradition locale; l'éco-
le qui forme des artisans en liaison étroite
avec cette tradition et continuant ses pro-
cédés, l'Office de ventes assurant à la pro-
duction les débouchés nécessaires et la vie
matérielle des artisans formés. -
* Des maîtres artisans désignés par l'opi-
nion indigène et qui avaient fait leurs preu-
ves. furent recrutés et nommés chefs d'ate-
lier. On leur donna l'outillage qu'il's de-
mandaient et qui était leur outillage tra-
ditionnel. En quelques mois, l'école était
créée par une agrégation naturelle. Depuis
io ans, elle fonctionne de la même manière.
Ses méthodes pédagogiques sont indigènes
et répondent par conséquent au tempérament
des individus et à la nature de l'art ensei-
gné. Elites sont à l'abri de l'influence fran-
çaise et naturellement soumises à l'évolu-
tion de la race et aux influences du milieu.
Au cours des premières années cet ensei-
ngement donné librement en cambodgien,
tel que 50 oubioo ans plus tôt dans les
villages ou les monastères, sans heurter au-
cune habitude, permit à la direction fran-
çaise, plutôt spectatrice et observatrice que
dirigeante, d'étudier l'art qu'elle voùlait
faire revivre et d'assister à sa mise en pra-
tique historique et naturelle,
A l'entrée, rien n'est exigé du candidat,
tinon qu'il ait 14 à 15 ans, sache lire et
écrire sa langue, sans exiger le français.
Il doit fréquenter l'école « en période
d'observation » et quand une place cPap.
prenti est libre, la direction y nomme le
meilleur et non pas le plus ancien des as-
pirants.
Observé par son patron et par. la direc-
tion française, s'il se montre inactif et ne
progresse pas, il est renvoyé immédiatement.
Au contraire, s'il est bien doué, actif, au-
cun délai fixe ne retarde sa carrière scolaire
et il est libre quand il le veut cPexécuter son
uvre de sortie. S'il réussit, il peut
pa-rfu, diplôme en poche, sinon il reste et
a droit encore à un essai.
Jamais d'examen, jamais de classement
tans valeur sur le tempérament Cambodgien,
mais, des primes scolaires proportionnées à
la valeur générale de l'individu (3, 4, 5
piastres par mois).
En pratique un artisan n'est formé qu'a-
près un minimum de deux ans et demi.
Une vingtaine d'élèves sortent chaque an-
née diplômés « artisans P, 40 à 50 autres
en moyenne sont renvoyés pour insuffisance
de travail, ce qui prouve qu'une sélection
sérieuse de l'apprenti est faite.
Celui-ci, presque formé, à la veille de
sa libération collabore avec le patron qui
fait le même travail. C'est du travail ef-
fectué par les mains les plus habiles que
sortent des types de décors, d'objets de tou-
tes sortes et de toute nature qui concré-
tisent l'enseignement. Ce répertoire des piè-
ces canoniques de l'art kmer marque le
« moment » de*l'art ; elles restent au musée
de l'Ecole qui constitue le musée national.
L'école ne doit produire dans chaque spé-
cialité qu un nombre d artisans déterminé
pour le pouvoir d'achat de la clientèle. Tout
çhômage, toute erreur doivent être évités, et
jl doit en somme y avoir une certaine rare-
té des œuvres d'art mises en circulation pour
conserver le prestige des artisans. La màln-
d'œuvre susceptible de se former en dehors
de ses ateliers peut le faire librement.
Si nous considérons que dans le plan ar-
tistique kmer, la main-d'œuvre seule compte,
l'enseignement - est - appelé à se prolonger
et aussi l'exécution de I'oeuvre, mais ce
maintien du travail purement manuel est
une garantie que par sa manière et sa for-
me, elle sera différente de ce qui se fait en
Europe et d'autant plus intéressante.
L'école assure donc le contrôle artisti-
que, la probité et la pureté de ses produc-
tions et leur écoulement à une clientèle for-
mée en grande partie de touristes qui vi-
sitent Pnom-Penh, formée aussi de Cam-
bodgiens riches qui reviennent au- goOt de
leur art national.
A l'Exposition coloniale, à la pagode du
Cambodge se trouvent de curieuses et ma-
gnifiques pièces d'orfèvrerie, de sculpture,
de fonte, de tissage exécutées par des élè-
ves de différentes écoles d'art indochinoîs.
Nous ne pouvons que rendre hommage
à ceux qui ont eu l'idée de créer ces éco-
les en Indochine et aux maîtres qui ont su
si bien les faire.. produire. Quant à la
rénovation de l'artisanat kmer, elle est au-
jourd'hui un fait accompli qui permet les
plus grands espoirs et est l'une des plus
intéressantes réussites de l'enseignement
technique en Indochine. - -1 - - -
Camille Briquet,
Député de l'Eure. Secrétaire de la Com-
mission de VAlgérie, des Colonies, et
des Protectorats.
.t..
En regardant une gravure
«»«
C'est une photo reproduite par le bulletin
d'un office international i
Sur un amoncellement inextricable de
têtes coupées et de cadavres de zèbres, un
chasseur est assis.
Casque sur l'oreille et pipe aux dents,
l'homme est triomphant. Il a battu la brous-
se une journée ; et dans la clairière, au pied
d'un arbre, voici le monstrueux trophée..
Il peut faire, et, peut-être, a-t-il déjà fait
rêver plus d'un Nemrod et même provoqué
le départ d'une troupe de massacreurs. Car
vers l'Afrique équatoriale, vers le Congo bel-
ge et plus loin, le Sahara offre aujourd'hui
des pistes parfaitement repérées, et les rou-
tes du ciel sont encore beaucoup plus libres.
Quiconque n'a pas la bourse trop plate peut
s'offrir en allant là-bas des émotions cynégé-
tiques particulièrement intenses.
Mais, est-il possible de rester indifférent
devant des destructions inutiles ?
Il y a trente ans, à Kayes, -on chassait le
canard en plein village indigène, et la grosse
bête aux environs immédiats de la ville. Il
en était de même dans tous les centres ha-
bités. Aujourd'hui il faut des randonnées de
cent kilomètres pour tirer un rat palmiste
En 1925, TOubangui exporta 50.000 kilos
d'ivoire.
En 1929, les sorties se réduisirent à 30.000
kilos.
Elles ne furent que de 16.000 en 1930.
Depuis que l'Afrique est l'Afrique, l'hom-
me sauvage et la bête ont vécu dans un étroit
voisinage, sans que celui-là, mangeur pour-
tant redoutable, soit parvenu à menacer
l'existence de celle-ci. La Nature avait, entre
eux, comme fixé un équilibre.
Un jour arriva l'homme blanc ; et voici,
en quelques années, les espèces animales
menacées de disparition.
Qui, chez nous, s'en préoccupe comme il
le faudrait ?
Et pourtant, en cette époque d'affaires et
de mercantilisme, il conviendrait de ne 'pas
oublier que nos commerçants du Congo ont
réalisé, grâce aux éléphants, des bénéfices
par millions, et que c'est dans la vente des
peaux de singes que les petits planteurs de
là Côte d'Ivoire ont trouvé, pour parer aux
effets de la crise, l'appoint qui leur était né-
cessaire. -
Voilà pour nos réalistes.
Pour les autres, rêveurs beaucoup plus
près de la réalité, comme tous les rêveurs,
et qui croient que la civilisation, comme la
vie elle-même n'est qu'une somme d'harmo-
nies, il reste que nous avons des devoirs en-
vers les bêtes.
L'Angleterre et la Belgique- y ont déjà
pensé. Elles ont créé dans leurs vastes do-
maines africains des réserves où viennent se
mettre à l'abri les aninaux traqués.
Mais nous arrivons bons demleTs.
C'est donc avec raison que le Gouverneur
général de l'A.E.F. a promulgué le décret
réglant les conditions de la chasse et arrête
le modalités de son application.
Son initiative a fçit des mécontents.
N'est-ce pas la preuve que lui-même a bien
fait ?
P..c. Ctwfw Français,
Gouverneur ivnowft fin Coionui.
Un regard sur Tahiti
-
J < h i t -" J
E Bulletin du Com-
merce de la Nou-
velle - Calédonie et
des Nouvelles-Hé-
brides du 18 juillet
1931 appelait l'at.
tention de la France
sur Tahiti,
Cette possession
française de l'Océqn
Pacifiaue mérite en
effet que la Métropole conserve l'oeil ou-
vert sur elle en raison des convoitises étran-
gères, de la mainmise de plus en plus resser-
rée et de la politique d'influence pratiquée
avec habileté par les Etats-Unis,
Les Etablissements français de l'Océanie)
dont, l'île Tahiti est la clé de voûte, sont
comme les autres pays dans une période de
dépression économique profonde. Tahiti de-
mande des mesures de protection.
C'est l'état général de nos colonies actuel-
lement, parce que si l'Europe et. les Etats-
Unis sont frappés lourdement par la crise
économique, les Colonies ne sont pas épar-
gnées.
- Demander à la mère-patrie des mesures
de protection 'est chose facile, mais reste va..
gue. Un programme de défense économique
bien établi vaudrait mieux. Tahiti réclame
un Conseil représentatif pour faire entendre
sa voix et préconiser des mesures de salut.
On peut accepter cette idée, mais il ne fau-
drait pas que les Tahitiens pensent qu'il suf -
fira d'un Conseil général pour ramener la
prospérité dans l'île.
En attendant, on peut croire que le mieux
serait que Tahiti élabore dès maintenant un
programme de restauration qui soit soumis
ait Gouvernement français.
Ch. Debierre,
Sénateur du Nord,
Membre de 14 commission
Sénatoriale des Allaires Etrangères.
ofte-
M. Lucien Saint
est rentré à Rabat
*♦«
M. Lucien Saint, résident général de Fran-
ce au Maroc, accompagné du chef de son ca-
binet militaire, le commandant Juin, est arri-
vé à Tanger, vendredi soir.
Il a regagné Rabat par la route, samedi.
Echange de télégrammes
En -quittant -le -téftttoira espagnol* le îwl-
dent général à tenu à exprimer à M. Herbette,
ambassadeur à Madrid, ses remerciements pour
l'accueil que lui a réservé l'ambassade.
M. Herbette lui a répondu dans les termes
suivants:
Profondément sensible à votre cordial télé-
gramme, je vous remercie du souvenir que vous
avez bien voulu garder de notre accueil et je
vous félicite encore du précieux ouvrage que
Vous avez fait ici pour développer entre les
Républiques espagnole et française celle ami-
lié qui me tient tellement à cœur.
M. Lucien Saint a adressé à M. Azana, pré-
sident du gouvernement de la République es-
pagnole le télégramme suivant :
Avant de quitter l'Espagne pour rejoindre
mon poste, je tiens à Vous exprimer mes remer-
ciements émus pour toutes les attentions déli-
cates dont j'ai été l'objet à Madrid de la part
du gouvernement de la République espa-
gnole.
J'emporte des entretiens cordiaux que j'ai
eus avec vous et vos éminents collaborateurs,
l'impression d'une amitié sans cesse plus étroi-
te et d'une parfaite unité de vues sur r œuvre
marocaine à laquelle l'Espagne et la France
s'emploient d'un mme cœur et dans un esprit
de loyale et confiante collaboration.
M. Azana a répondu :
Je vous remercie de votre télégramme et,
avec ma haute considération et mon amitié, je
tiens à vous renouveler le désir du gouverne-
ment de la République espagnole de maintenir
sans cesse avec la France une étroite collabo-
ration loyale et confiante dans l'œuvre maro-
caine.
-Me-
nLjpART
868
M. Ponsot rejoint son poste
M. Henri Ponsot, haut commissaire de la
République en Syrie et au Liban, et Mme
Ponsot sont partis de Paris hier pour Mar-
seille où ils s'embarquent aujourd'hui à
destination de Beyrouth. Le haut commis'
saire, au cours de son séjour à Paris, a pu
examiner et mettre au point les différents
problèmes qui se réfèrent à notre action au
Levant. On se rappelle qu'au cours de la
session de septembre dernier, la Commission
des mandats de la Société a donné son ap-
probation à l'œuvre accomplie par le repré-
sentant de la France en Syrie.
M. Ponsot a été saï&é à la gare de Lyon
par M. de Saint-Quentin, représentant M.
Briand, M. Pierre-Alype, délégué à Paris du
haut commissariat de la République en Sy-
rie, et par de nombreuses personnalités du
monde diplomatique.
En même temps que M. Ponsot, sont par-
lis ; M. Tetreau, secrétaire général du haut
commissariat ; M. Solomiac, délégué à Da-
mas; M. Neyrac, attaché au cabinet, et les
capitaines Terrier et Lauras.
A 1-1 natitut
I
Vacance de fauteuil
-- Il'' 11 1
Dam leur dernière réunion les membres de
l'Institut ont déclaré vacant le fauteuil du re-
gretté architecte Deglane, dont le successeur
sera élu le 28 novembre.
A la Sorbonne
Une belle leçon coloniale
Décidément, il y a quelque chose de
changé, les cloisons ont sauté et la France
(Poutre-mer pénètre jusqu'au cœur de l'anti-
que fondation de Robert de Sonbon.
Certes, nous sommes loin du temps où
l'Université de Paris s'abritait dans les
vieilles masures de la Montagne-Sainte-Ge-
neviève, concédées par le roi Saint-Louis à
son chapelain.
En cette séance solennelle de rentrée, M.
Paul Doumer, président de la République;
M. Mario Roustan, ministre de l'Instruction
publique; M. Charléty, recteur et les mem-
bres du Corps universitaire ne s'assirent pas
sur les escabeaux de bois des maîtres du
moyen âge, près des bottes de paille réser-
vées aux élèves.
Confortablement tnstallée dans le grand
amphithéâtre de la Sorbonne, l'éminente as-
sistance put apprécier le magistral discours
de M. Charléty, gonflé par les vents du
large qui nous apporte, des cinq parties du
monde, le visage de la France intégrale.
Le premier devoi** des Universités est, en
effet, d'indiquer le changement d'échelle des
problèmes de notre temps et de former les
jeunes hommes qui se trouveront demain en
face d'un empire.
Voici quelques passages de ce discours
qui élargit singulièrement la vision de ceux
qui, un jour prochain, peuvent commander
aux destinées de la plus grande France :
« Le Français, quelle que soit sa condi-
tion, ne vit plus ignorant, replié et satisfait.
Une porte est enfoncée. Le vigneron du Midi
surveille non sans inquiétude celui de l'Afri-
que du Nord. Il y a des villes dont la po-
pulation oscille d'une dizaine de mille âmes
suivant le cours du caoutchouc ; et l'on y
sait que le phénomène a son origine dans
l'Asie tropicale. Toute notre vie est envahie
de sensations étrangères. Voilà beau temps
que le Savoyard et sa marmotte ont été rem-
placés dans les types populaires de la rue
par le ,Kabyle et ses tgipis. Le bétail du
Nord consomme du manioc de Madagascar
et nous mangeons autant de bananes que de
pommes. L'essence de votre voiture vient de
partout sauf de chez nous. Il faudrait être
sourd pour épargner à ses oreilles la plus
redoutable des importations celle de la mu-
sique nègre. »
,. l' Il.
« Ainsi le phénomène colonial nous paraît
aujourd'hui le phénomène central de - l'his-
toire du monde. Notre part y est belle. Nous
l'avons conquise un peu par inadvertance ;
et c'est un échantillonnage magnifique de la
planète. Mais le jeune Français moyen le
sait-il bien et le croit-il consciemment à
cette heure? Il semble qu'il se méfie : pour-
tant il est obscurément troublé. Il va a l'Ex-
position et on lui dit que pareil succès ne
s'était'-pas ifit-éetrois la dernière Exposition
universelle, il y a trente et un ans. -11 sent
confusément que colonial et universel sont
devenus synonymes. »
M. Charléty rendant hommage à l'admi-
nistrateur civil colonial, ajoute :
« Métier admirable qui s'empare de tout
l'homme parce qu'il le forme, lui laissant de
l'initiative et des responsabilités. A-t-il chez
nous le retentissement qu'il devrait avoir ?
Donnons-nous à notre excellente école colo-
niale qui les éduque tout ce que nous pour-
rions lui offrir de valeurs désireuses de se
soustraire aux routines, aux misères, à
l'usure de l'administration métropolitaine ?
Placée devant les magnificences et les dan-
gers de notre empire, notre jeunesse, notre
élite morale et scientifique en doit acquérir
clairement le souci. Quel est celui de nos étu-
diants qui rêve d'être le grand chef futur,
après une carrière impériale?
« C'est en pensant à ce jeune Français,
monsieur le Président de la République, que
je vous apporte la respectueuse reconnais-
sance de l'Université. Votre présence nous
est chère; elle nous rappelle l'amicale bien-
veillance du Président du Sénat que le chef
de l'Etat veut bien ne pas oublier.
« C'est pourquoi, ayant fait, comme tout le
monde, une promenade à l'Exposition Colo-
niale, ayant comme tout le monde lu quel-
ques beaux livres, d'aujourd'hui dont l'un
accable de remords les historiens que nous
sommes, j'ai cru pouvoir proposer à votre
habituelle indulgence cette sévère et peut-
être indiscrète méditation. »
Le discours de M. Charléty a été chaleu-
reusement applaudi. Puisse-t-il porter ses
fruits dans toutes les allées de la riante Cité
universitaire où déjà, le dragon, le lotus et
bien d'autres totems planétaires sont
comme chez eux.
M.-L. Si
A la Société des Nations
La Commission des Mandats
La Commission des mandats a examiné
hier lundi le rapport annuel du gouverne-
ment français sur l'administration du Togo,
placé sous son mandat, en piésence de M.
Besson chef du premier bureau du départe-
ment politique du ministère des Colonies.
Après avoir remercié la puissance manda-
taire des renseignements fournis dans son
rapport, le président de la Commission a
rappelé une question qui avait été soulevée
lors de la précédente session, en ce qui
cohcèrne la délimitation des frontières du
- Togo.
La Commission a demandé des renseigne-
ments au représentant accrédité sur diffé-
rents points. Elle s'est occupée également
des finances du territoire et de la situation
du pays, au point de vue commercial.
En ce qui concerne les conditions du tra-
vail au Togo, le représentant accrédité a dé-
claré que l'administration offre des salaires
suffisamment élevés pour recruter une main-
d'œuvre suffisante pour les besoins des tra-
vaux publics. Aucune réquisition des travail-
leurs n'est permise au Togo, en vue de
l'entreprise privée.
Enfin, le représentant accrédité a énu-
méré les efforts accomplis par la puissance
mandataire, en vue de faire face aux besoins
sanitaires du pays, notamment dans la lutte
contre la lèpre et la maladie du sommeil.
le Sénégal en 1931
.t.
A quoi sert le manioc
cu J'ai dans un précédent article: traité de la
culture du manioc.
Je vais aujourd'hui essayer de donner quel-
que aperçu sur les nombreux et utiles emplois
de sa racine.
Lorsque la farine de manioc ne doit pas
être consommée presque immédiatement, on la
convertit en couac et en cassave.
Le-couac qui peut être jaune ou blanc, s'ob-
tient, en jetant la farine humide et salée sur
une plaque chauffée, et en la faisant passer
dans un tamis à mailles assez grosses. La pla-
que chauffée est en tôle ou eu.. fonte, et ma-
çonnée généralement sur un fourneau alimenté
au bois. La cuisson ne doit pas dépasser un
certai n degré, et, pour que la farine n'adhère
pas à la plaque, il faut la remuer sans cesse
avec une palette ou un râteau en bois, et ce-
pendant tout le temps de la cuisson. Cette fa-
rine se conserve très longtemps si on la met
dans un endroit sec, et s'emploie comme la
farine fratche.
Pour la cassave, la farine de manioc doit
être plus finement tamisée que pour le couac.
Elle est convertie en galettes, fines ou en crê-
pes en employant le même mode de procéder
que pour le couac, seulement au lieu de re-
muer la farine sur la plaque pendant toute la
durée delà cuisson, on l'étale circulairement,
et on lui fait subir une certaine pression, pour
que toute la masse s' agrège. On retourne la
galette ou la crêpe deux ou trois fois pour
qu'elle soit bien cuite.
La cassave se'conserve comme le couac et
aussi longtemps.
Du liquide laiteux qui s'est écoulé pendant
la préparation de la farine, et qu'on laisse re-
poser, on tire une fécule très fine qui est usitée
comme empois. Cuite au four, elle peut, si
on le veut, être employée pour faire, comme
au Brésil, des gâteaux fins très appréciés là-
bas. Si on la met en bouillie légère, elle de-
vient un aliment très reconstituant pour les en-
fants et les convalescents. Enfin, avec cet ami-
don on fait le tapioca.
Pour obtenir celui-ci en grande quantité et
industriellement, il faut préparer spécialement
les tubercules de variétés à grand rendement.
Le plan général d'une usine à tapioca est,
grosso modo, le même que celuj d'une fécule-
rie de pommes de terre. Il y a cependant quel-
,. il y a
ques modifications : elles portent surtout sur
les râpes qui doivent être bien plus fortes et
robustes pour les tubercules de manioc, fer-
mes et résistants, que pour les ponimes de terre.
Pour être convertie en tapioca, la fécule est
cuite et granulée. Elfe passe par pression à
travers un tamis et tombe sur une surface chauf-
fée à 1500. Au contact de cette- surface, les
grains d'amidon se dextrinisent, et s agglo-
mèrent en grumeaux plus ou moins gros. Ces
grumeaux sont désséchés à l'étuve, concassés
et classés de façon à former finalement des
granules de grosseur uniforme.
Telle est, dans ses très grandes lignes la
fabrication du tapioca. On le prépare surtout
au Brésil, à Singapour et un peu à Madagascar
et à la Réunion. Il serait très souhaitable
qu'une ou plusieurs usines de ce genre se
créent au Sénégal, conjointement avec des
plantations industrielles de manioc, dont elles
seraient le complément tout indiqué. Ce se-
rait Une utilisation de leur récolte, infiniment
plus intéressante pour ces plantations, que
l'envoi qu'elles font en France actuellement
des cossettes séchées qu' elles expédient à
Marseille, où elles sont achetées depuis quel-
ques mois à un prix qui ne couvre même pas
les frais de culture et de transport.
Les industriels se lançant dans une exploita-
tion de ce genre, bénéficieraient pour la vente
de leur produit, du bon marché relatif de la
main-d' œuvre locale, de la facilité avec la-
quelle on la recrute, dans certains cantons,
tout au moins, et surtout de la proximité de la
France. On économiserait des frais de trans-
port considérables. Or on sait l'importance
de ce facteur dans l'établissement des prix de
revient actuels.
Naturellement, pour créer semblable indus-
trie il faut: la grande plantation, avec un ma-
tériel de culture mécanique approprié pour les
opérations qui peuvent se pratiquer ainsi, tel
au moins le labour ; l'eau en quantité suffi-
sante et de qualité permettant la création de la
féculerie. Enfin, la proximité d'un port, ou, à
défaut, d'une ligne de chemin de fer. Mais le
port est de beaucoup préférable, le fret par
eau étant - bien moins cher. Enfin, n'oublions
pas que si on a de 1 eau en quantité suffisante,
on peut, comme nous l'avons déjà dit, planter
le manioc toute l'année. On voit, sans qu'il
soit besoin d'insister, l'avantage qui peut dé-
couler de cette facilité de travail, et quelle
augmentation de rendement on peut espérer.
Ce serait aussi pour la colonie une source
de richesse économique nouvelle qui viendrait
singulièrement à point. -
Ainsi comprise, la culture du manioc four-
nirait aux indigènes une alimentation écono-
mique et excellente. Elle deviendrait pour les
européens disposant d'une plantation impor-
tante, menée avec intelligence, et ayant de
l'eau en quantité suffisante pour organiser une
féculerie, une source très probablement assurée
de bénéfices : pour la colonie, il serait inté-
ressant d'avoir une nouvelle corde à son arc,
en voyant se créer yne industrie susceptible de
fournir des matières à exporter.
Tout le monde y trouverait son compte.
Louu Le Barbier.
LIRE EN SECONDE PAGE :
ArExpositioncoloTdatc.
L'Aviation coloniale.
A la Chambre.
Répertoire de l'Officiel.
Un concours agricole
au Gabon
1..
Le concours agricole avec Foires-Expositions
organisé par le lieutenant-gouverneur du
Gabon, eut lieu récemment dans trois grands
centres de la colonie : Libreville, Port-oon-
til et Lambaréné. La manifestation fut sui-
vie avec un réel intérêt par les populations
européenne et indigène, qui comprirent l'im-
portance du développement agricole du pays.
Pour les cultures maraîchères, la production
pendant la saison sèche, permet maintenant
de satisfaire les besoins de la population de
Libreville et d'approvisionner en partie les
vapeurs de charge de passage.
Le développement des cultures potagères
est remarquable ; certains indigènes devien-
nent de véritables maraîchers dirigeant un
grand nombre de manœuvres et s associant
parfois dans les achats de semences pour le&
cultures et la vente des légumes. Générale-
ment, les indigènes possèdent surtout un pe-
tit jardin familial dont l'excédent vendu sur
le marché constitue des sources supplémen-
taires appréciables de revenus. Concernant
l'élevage, on constate l'amélioration des ra.
ces autochtones. Les efforts de l'administra-
tion tendent maintenant à introduire des es-
pèces nouvelles afin de varier la nourriture
des indigènes. Les semences légumineuses
riches en azote seront notamment distribuées.
Comme les années précédentes, la section
économique domestique réunit de nombreux
exposants. L'Exposition d'ameublement ré-
véla que les indigènes sont capables de fa-
briquer de beaux meubles.
Au concours agricole du Gabon, grâce aux
crédits délégués par M. le gouverneur géné-
ral Antonetti, les primes données en récom-
pense furent plus importantes que les an-
nées précédentes. Les animaux reproducteurs
sélectionnés de basse-cour, importés de
France, furent répartis entre les exposants,
surtout Européens, ceux-ci étant encore les
seuls, susceptibles de donner à ces animaux
les soins nécessaires à leur acclimatement.
Les produits de croisement obtenus avec
ceux des précédents concours, engagent
les producteurs à persévérer dans cette voie.
Afin d'améliorer les porcins du pays, mal
conformés, les couples issus des porcs yorks-
hire importés l'an dernier, furent répartis
entre les éleveurs importants. Les instru-
ments d'outillage furent remis aux jardi-
niers méritants.
A la section de Port-Gentil, l'échantillon
de pétrole brut exposé par la mission pétroll-
fère obtint un vif succès. Les produits de
chasse furent tirs nombreux cette année ; les
circonscriptions voisines participèrent à cette
manifestation. Signalons la présentation de
deux jeunes éléphants âgés de neuf mois. De
grosses quantités de poissons furent expo-
sées : le lamantin occupait la place d'hon-
neur.
La section agricole de Sambaréné permit
de constater les efforts déployés par les in-
digènes pour varier et accroître les produc-
tions ouvrière et industrielle. La culture du
poivre, entrepi ise depuis plusieurs années,
sera développée. Les produits d'élevage fu-
rent exposés en grand nombre. Le concours
agricole a créé une émulation croissante. Il
est d'un haut intérêt économique. ; les indi-
gènes comprennent la portée de cette mani-
festation.
.,.
La lutte contre les acridiens
On signale au Tchad un nouvel élément
de destruction des acridiens : coléoptère dont
l'aspect rappelle celui d'un petit scarabée et
que les indigènes nomment goudgoud en
Fezzajiais, tchoutgouda en (Kenembou et en
Gorane. Ces insectes attaquent les œufs de
sauterelles dont ils font une consommation
formi'l;,blc, et seraient abondants cette an-
née, contrairement à l'an dernier.
Les piastres sortent des bas
de laine indochinois
»♦«
On signale depuis quelque temps en In-
dochine qu'on voit affluer aux guichets des
banques et dans les boutiques, des piastres
souillées de terre, piastres métalliques aussi
bien que piastres en papier des plus vieux
modèles.
Leur origine se voit aisément.
Elles sortent des trous où les indigènes les
conservaient, selon une habitude bien
connue.
Un journal de Saigon fait remarquer que
s'il est d'une bonne économie politique que
l'argent roule, c'est à condition de revenir
à son point de départ et grossi comme la
boule de neige.
Or, dans le cas qui nous occupe, c'est ce
retour rémunérateur qu'on n'aperçoit pas. Si
les thésauriseurs se démunissent, c'est qu'ils
attaquent leurs réserves à un moment où ils
ne peuvent plus, par un travail régulier, se
procurer les sommes nécessaires aux dépen-
ses do la vie courante.
Ce symptôme n'est évidemment pa- rassu-
rant.
Nous le rapprochons d'un autie fait du
même ordre que nous avons signalé ici mê-
me la vente, toujours par les indigènes
pressés par le besoin, de titres de rente long-
temps restés en leur possession, et ratlés à
bas prix par des Chcttys et autres usuriers
sans conscience. Ici, la Banque rke l'Indo-
chine a pu arrêter le louche trafic, en rache-
tant les titres en question au cours du jour.
L'indigène a évité ainsi de grosses pertes.
Mais n'est-ce pas un symptôme aussi de la
situation économique actuelle, que connaît
notre grande colonie de l'Extrême-Orient,
comme d'ailleurs toutes les autres:
L'explorateur Norden est mort
1 1
L'explorateur américain TTermann Norden,
célèbre auteur et conférencier, vient de mou-
rir subitement à Londres, dans la rue. M.
Xordcn est l'auteur d'ouvrages Fur l'Indo-
chine, l'Annam et l'Océanie.
Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 82.93%.
En savoir plus sur l'OCR
En savoir plus sur l'OCR
Le texte affiché peut comporter un certain nombre d'erreurs. En effet, le mode texte de ce document a été généré de façon automatique par un programme de reconnaissance optique de caractères (OCR). Le taux de reconnaissance estimé pour ce document est de 82.93%.
- Auteurs similaires Ruedel Marcel Ruedel Marcel /services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&maximumRecords=50&collapsing=true&exactSearch=true&query=(dc.creator adj "Ruedel Marcel" or dc.contributor adj "Ruedel Marcel")
-
-
Page
chiffre de pagination vue 1/2
- Recherche dans le document Recherche dans le document https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/search/ark:/12148/bpt6k63804223/f1.image ×
Recherche dans le document
- Partage et envoi par courriel Partage et envoi par courriel https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/share/ark:/12148/bpt6k63804223/f1.image
- Téléchargement / impression Téléchargement / impression https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/download/ark:/12148/bpt6k63804223/f1.image
- Acheter une reproduction Acheter une reproduction https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/pa-ecommerce/ark:/12148/bpt6k63804223
- Acheter le livre complet Acheter le livre complet https://numba.cirad.fr/services/ajax/action/indisponible/achat/ark:/12148/bpt6k63804223